Partitions : les petites perles des Editions Symétrie
Toujours en recherche de nouveaux répertoires, les Editions Symétrie nous a gratifié ces derniers mois d'un florilège de découvertes couvrant plus de deux siècles allant de Gossec, Reicha et Gluck à notre contemporain Guy Sacre en passant par Le Duc, Hérold, de La Tombelle, Saint-Saëns, Bordes et Janacek. Des oeuvres pour voix, pour orchestre, pour la harpe, la flûte, le piano... faites votre choix.
Nous laissons à l'éditeur le soin de vous présenter ces oeuvres rares.
Paysages tristes de Charles Bordes (1863 – 1909)
Soleils couchants - Chansons d'automne - L'Heure du berger - Promenade sentimentale.
Premier cycle de mélodies françaises consacré aux Poèmes saturniens de Verlaine, les Paysages tristes de Charles Bordes constituent une tentative remarquable de mise en pratique de la forme cyclique adaptée au répertoire vocal. En la matière, l’œuvre est à rapprocher – stylistiquement et chronologiquement – de la Sonate pour violon de César Franck, avec qui Bordes prenait alors des cours de composition.
L’unité du cahier repose en grande partie sur l’usage de thèmes musicaux récurrents et sur l’importance particulière donnée à l’intervalle de tierce majeure tout au long du cycle, que l’on discerne en particulier dans le plan tonal original de l’œuvre. Dans ce cahier construit en forme d’arche, la dernière mélodie rassemble de nombreux éléments entendus précédemment – elle cite notamment de façon évidente le postlude et le thème pianistique central de la première.
Mais le talent de Bordes ne se réduit pas à la réalisation d’une expérience formelle. Toute l’ambiance du cycle traduit en effet de manière saisissante l’atmosphère lourde, maladive, crépusculaire des poèmes de Verlaine. Le compositeur explore cet accablement dans un univers musical empreint de chromatisme et de lenteur, sans toutefois renoncer à de furtives envolées vocales ou pianistiques où se traduit tout le lyrisme de son tempérament.
Pour voix moyenne et piano. Durée : environ 12 minutes.
Jean-François Rouchon
 Orphée et Eurydice de Christoph Willibald Gluck (1714 - 1787)
Orphée et Eurydice de Christoph Willibald Gluck (1714 - 1787)
Tragédie en trois actes sur un livret de Pierre-Louis Moline
Avec Orfeo ed Euridice, Gluck s’oppose à plus d’un siècle et demi de tradition italienne et s’impose comme une figure incontournable de l’histoire de l’opéra. En collaboration avec Calzabigi, il réfute la prouesse technique des airs virtuoses des opéras italiens et promeut la simplicité et « l’expression directe et sincère du sentiment ». Cependant, la version de 1762 est moins dense que l’Orphée et Eurydice de 1774, établie avec Pierre-Louis Moline afin d’adapter le livret de Calzabigi à la langue française : Gluck a revu la partie vocale du héros, qui passe de la voix de castrat à celle de ténor, et ajouté à la version d’origine quelques pièces vocales ou orchestrales.
L’ouverture, en do majeur, a survécu aux remaniements du compositeur. Son caractère enjoué et festif diffère de l’ambiance plus sombre de la tragédie qu’elle présente. Elle est construite selon une forme sonate monothématique reconnaissable par son plan en trois parties : une exposition qui introduit deux thèmes, l’un dans le ton principal et l’autre à la quinte, puis un développement et, enfin, une réexposition reprenant les deux thèmes principaux de la première partie dans la tonalité initiale.
La partition de 1774 bénéficie des modifications opérées par Gluck qui introduit des pièces originales et des reprises de partitions antérieures, notamment dans l’acte II. Avec ses deux tableaux antithétiques représentant les Enfers puis les Champs Élysées, cet acte juxtapose aussi bien des paysages que des émotions contrastées. L’« Air des Furies », originellement composé pour le ballet Don Juan, conclut le premier tableau par une danse dantesque des créatures démoniaques avant de disparaître dans les abysses. Gluck révolutionne à nouveau l’opéra en nous livrant une image effrayante des Enfers grâce à des rythmes de cordes effrénés et des enchaînements d’accords dissonants intensifiés par les cuivres. Cet « Air des furies » est d’autant plus impressionnant qu’il s’oppose à la pièce suivante, modifiée elle aussi pour la version française. Le « Ballet des ombres heureuses » introduit parfaitement le deuxième tableau que forment les Champs Élysées. Avec un remarquable menuet de forme binaire à reprise, déjà présent dans l’Orfeo ed Euridice, Gluck peint un paysage idyllique, paisible et coloré. Le compositeur a néanmoins ajouté à sa version initiale un trio en ré mineur composé d’un chant à la flûte solo, « soutenue par le fluide accompagnement des violons comme par le murmure des ruisseaux ».
Orphée et Eurydice rencontre un succès considérable auprès du public français au point de convaincre les éléments les plus hostiles à la tragédie lyrique française. Ainsi, Jean-Jacques Rousseau, défenseur convaincu de l’opéra italien, tomba sous le charme de cette pièce et aurait déclaré : « Puisqu’on peut avoir un si grand plaisir pendant deux heures, je conçois que la vie peut être bonne à quelque chose. »
Partition d'orchestre. Ouverture : durée environ 8 minutes. La Suite d'orchestre (Ouverture, Ballet des Ombres heureuses, Air de furies). Durée environ 17 minutes.
Manon Bertaux
 Symphonie en ut mineur op. 6 n°3 de François-Joseph Gossec (1734 - 1829)
Symphonie en ut mineur op. 6 n°3 de François-Joseph Gossec (1734 - 1829)
Les 6 Symphonies op.6 sont composées en 1762 alors que Gossec est intendant de la musique chez les princes de Condé et de Conti. La troisième, en do mineur, comporte trois mouvements, coupe caractéristique des trois-quarts des symphonies de cette époque : allegro, minuetto grazioso et fugato. L’orchestration est typique des premières symphonies de Haydn (pupitre de vents réduit à deux hautbois et deux cors), mais elle s’inscrit aussi dans le mouvement Sturm und Drang (tempête et passion), mouvement politique, littéraire et musical qui apparaît à la fin des années 1760 et se caractérise par un goût marqué pour les tonalités mineures ou les effets imprévus.
Partition d'orchestre. Durée : environ 15 minutes.
Élodie Girard
 Symphonie n°2 en ré majeur de Louis-Ferdinand Hérold (1791 – 1833)
Symphonie n°2 en ré majeur de Louis-Ferdinand Hérold (1791 – 1833)
Seconde et dernière symphonie de Hérold, la Symphonie n° 2 en ré majeur est composée à Naples en mai 1814. Dans une lettre à sa mère, le compositeur écrit : « Dis bien des choses à M. Méhul. Je viens de faire une symphonie dont j’espère qu’il ne sera pas mécontent », avant d’ajouter quelques semaines plus tard que « l’Andante et le Rondo ont produit beaucoup d’effet. » Dans une lettre plus tardive, il déclare : « La symphonie que j’envoie à l’Institut a été jouée trois fois ici avec succès par un orchestre médiocre. »
Profondément influencé par Joseph Haydn et Ludwig van Beethoven, Hérold construit sa symphonie sur le socle classique (l’orchestre est néanmoins dépourvu de trompettes et de timbales), avec des couleurs harmoniques plutôt ancrées dans l’ère romantique.
La symphonie se subdivise en trois mouvements : un premier, allegro molto, précédé d’une Introduzione. Largo. Un second, andante, et un troisième et dernier, rondo prestissimo.
L’Introduzione. Largo avec ses rythmes pointés, suggère une ouverture à la française qui ne manque pas d’évoquer la Symphonie n° 85 dite « La Reine » de Haydn, hommage à la musique française. S’ensuit un allegro molto de forme sonate qui, encore courante à cette époque, se distingue cependant par son second thème valsé très léger, inattendu bien que fort courant dans la musique de salon. L’andante en fa majeur débute sur deux thèmes qui seront par la suite variés, le premier étant teinté de gaité quand le second est plus intérieur. Ce mouvement se caractérise par ses couleurs harmoniques très prononcées, faites d’ombres et de lumières. L’orchestration y est plus sobre : la clarinette disparaît et les pupitres de cordes et de bois se répondent dans une écriture en imitation.
Le troisième et dernier mouvement se voit attribuer la mention rondo. Bien qu’étant la seule indication, cette mention est approximative : le final tend vers un rondo-sonate, mais reste néanmoins très singulier structurellement. Les violons jouent un très grand rôle dans le refrain en exposant, seuls, une longue phrase mélodique qui aboutit à une formule plus harmonique. Hérold effectue une sorte de synthèse des styles italiens et français, deux pays importants dans sa formation. Le final, empreint de malice, n’est pas sans rappeler ceux des dernières symphonies de Haydn et condense l’esprit général de l’œuvre : le désir de surprendre avec des éléments pourtant bien traditionnels.
Partition d'orchestre. Durée : environ 18 minutes
Victor Monteragioni
 La Petite Renarde rusée de Leos Janacek
La Petite Renarde rusée de Leos Janacek
Transcription pour ensemble instrumental de Didier Puntos (2014)
L’écriture musicale et orchestrale foisonnante de la Petite Renarde rusée ouvre d’infinies possibilités d’adaptation. Cette adaptation cherche à en restituer la lumineuse complexité en s’appuyant sur une formation chambriste : piano, violon, violoncelle, flûte, clarinette et percussion. Une manière de faire entendre cette « histoire gaie avec une fin triste » selon les mots du compositeur, au plus près des mots et notes de Janacek…
Durée : environ 1h35'. Les 3 actes sont publiés en 3 cahiers séparés.
Didier Puntos
 Variations en forme de chaconne pour violoncelle avec accompagnement de piano de Fernand de La Tombelle (1854 - 1928)
Variations en forme de chaconne pour violoncelle avec accompagnement de piano de Fernand de La Tombelle (1854 - 1928)
D’allure tout à fait classique, les Variations en forme de chaconne furent interprétées en première audition le 23 février 1902 par Gaston Courras, violoncelliste de l’opéra de Paris, et l’auteur au piano. Cette pièce s’inscrit dans le mouvement de redécouverte des maîtres clavecinistes du Grand Siècle qui s’opère au tournant des 19 et 20e siècles. On sait par ailleurs l’intérêt que portait La Tombelle à des compositeurs comme Couperin ou Rameau, les exécutant lui-même souvent en concert. D’autres œuvres de ce compositeur font également référence de manière explicite à une certaine forme de classicisme hérité du passé. Pensons par exemple à la Passacaille ou à l’Air varié dans le style ancien pour violon et piano, à la Toccata dans le style ancien de la Suite d’orgue pour le temps de Noël ou encore à la Suite pour 3 violoncelles.
Pièce brillante de concert, ces Variations en forme de chaconne allient l’apparente simplicité du matériel de base employé à une grande virtuosité mettant en avant l’interprète.
Partition violoncelle et piano et partition violoncelle. Durée : environ 10 minutes.
Jean-Emmanuel Filet
 Suite courte pour flûte et harpe chromatique (ou piano) de Fernand de La Tombelle (1854 - 1928)
Suite courte pour flûte et harpe chromatique (ou piano) de Fernand de La Tombelle (1854 - 1928)
Conservé aux archives du diocèse de Périgueux et Sarlat, l’unique manuscrit autographe connu de la Suite courte pour flûte et harpe chromatique ne porte aucune date. Cependant, deux informations pourraient permettre de donner une datation approximative de cette œuvre. Tout d’abord, un document écrit de la main du compositeur mentionne cette œuvre et précise « chez Fougeray ». Cet éditeur publiera plusieurs ouvrages de La Tombelle après la Première Guerre mondiale et il semblerait que la Suite courte devait l’être un jour. En outre, à la lecture du catalogue complet du musicien, on remarque la présence de plusieurs morceaux de musique de chambre intitulés « Suite » durant les années de guerre. Pensons à la Suite pour trois violoncelles, composée vers 1914 et éditée par Maurice Senart en 1921, ou encore à la Suite brève pour deux violons et piano, pièce en quatre mouvements aujourd’hui perdue, dédiée très certainement à Fernand et Jacques Lespine et créée avec le concours de l’auteur en 1916. L’essentiel de la production de La Tombelle composé durant le premier conflit mondial étant demeuré inédit, il est permis de se demander si la Suite courte ne daterait pas de cette période.
Divisée en trois mouvements, l’œuvre débute par un Prélude usant largement de carrures régulières, de marche de septièmes sur le cycle des quintes, d’harmonies sur pédale de tonique ou dominante, de cadences parfaites traditionnelles. Ces éléments marquent de la part de La Tombelle une volonté de retour à un certain classicisme, comme c’est le cas dans d’autres de ses pièces composées à la même période. Contraste total dans le second mouvement, "Improvisation", qui lui, comme son titre l’indique, propose une plus grande liberté de forme. Ainsi, on trouve ici des accompagnements en arpèges, des sons harmoniques, une plus grande variété rythmique, de courts passages similaires à des cadenza. L’introduction de cette seconde partie n’est d’ailleurs pas sans rappeler une autre œuvre pour harpe du compositeur : la Fantaisie Ballade pour harpe à pédales. Après le temps du rigorisme, puis celui de la souplesse, vient avec le troisième mouvement le moment de la Danse. Alliant la précision rythmique du premier à la fantaisie du second, ce bref mouvement conclut l’œuvre de manière enjouée avec l’emploie de rythmes répétitifs syncopés dans l’accompagnement et pointés dans la partie mélodique dévolue à la flûte.
Tout au long de la pièce, la tonalité principale reste celle de la mineur, ce qui confère une cohérence générale, mais la différence de caractère des trois mouvements offre également à cette Suite courte une réelle variété de ton.
Compte tenu de la rareté des instruments chromatiques de la maison Pleyel de nos jours, on ne peut que conseiller d’interpréter cette œuvre, soit en l’adaptant quelque peu pour la harpe diatonique, soit en la jouant telle qu’écrite, mais au piano.
Partition flûte et harpe chromatique et partition flûte. Durée approximative : 11 minutes.
Jean-Emmanuel Filet
 Symphonie en mi bémol majeur de Simon Le Duc (1742 - 1777)
Symphonie en mi bémol majeur de Simon Le Duc (1742 - 1777)
Selon l’édition originale, cette symphonie fut jouée pour la première fois au Concert des amateurs – société de concerts en concurrence avec le Concert spirituel – en 1777, année du décès de Le Duc. Elle présente une fusion des styles germanique (école de Mannheim), français et italien. Simon Le Duc subit indéniablement l’influence italienne, comme à peu près tous les symphonistes de son époque, dans la structure de l’œuvre : trois mouvements, vif-lent-vif. Il y joint cependant l’expressivité germanique grâce à une orchestration caractéristique de l’école allemande et utilise la virtuosité propre à l’école française, particulièrement pour le violon, son instrument.
Son style avant-gardiste est défini par l’emploi de rythmes très diversifiés qui font l’objet de courtes sections. Les contrastes dynamiques, omniprésents, sont efficaces et spectaculaires. Dans l’ensemble, l’harmonie reste simple. Cependant, l’emploi dans la première partie d’un accord de septième diminuée (mes. 139) caractérise une recherche de style et de couleurs préfigurant les grandes symphonies pré-romantiques. Les flûtes et les cors donnent de l’épaisseur au tissu harmonique tandis que les violons se détachent par une ligne mélodique contrastée. Les instruments à vent jouent rarement seuls et sont employés avec beaucoup de finesse. Le chromatisme, employé non seulement dans les pupitres intermédiaires, mais aussi dans la mélodie renforce le caractère expressif.
La symphonie débute par un un allegro vivace précédé d’une introduction lente maestoso qui met en valeur le caractère plein d’allégresse de cette section. La beauté du second mouvement se fait ressentir par l’emploi de retards, de tuilages et de sixtes napolitaines, intervalles très souvent utilisés pour donner un caractère dramatique et poignant. Cet adagio sostenuto émouvant contraste avec le dernier mouvement de la symphonie, un rondo moderato dynamique et léger. Le thème est traité de manière différente à chaque reprise, soit en tierces, soit avec les vents qui ont un rôle plus actif dans cette troisième partie que dans les deux autres. À la simplicité du thème s’ajoute la légèreté française des ornements en doubles ou triples croches qui donnent à ce rondo sa délicate particularité, faisant d’autant plus ressortir la gravité et la profondeur du mouvement central.
Enlevée, dense et expressive, cette symphonie de Simon Le Duc est, selon Barry S. Brook, « un des chefs-d’œuvre de la musique symphonique du XVIIIe siècle ».
Partition d'orchestre. Durée : environ 15 minutes.
Camille Subiger
 34 Etudes dans le genre fugué op. 97 d'Antoine Reicha (1770 - 1836)
34 Etudes dans le genre fugué op. 97 d'Antoine Reicha (1770 - 1836)
Cette édition de l’œuvre intitulée 34 Études dans le genre fugué publiée en quatre cahiers, se fonde sur celle publiée en deux volumes de 17 études en 1820 par Érard à Paris. Celle-ci commence par une préface du compositeur suivie de 16 remarques portant sur certaines des études. La présente édition reproduit cette préface et ces remarques. L’œuvre fut rééditée en 1840 par Schonenberger sous le titre La fugue et le contrepoint mis en pratique et appliqués au clavier du piano. À part une erreur d’armure, la notation est identique à celle de l’édition de 1820, la seule différence importante étant que les remarques sont placées à côté des études auxquelles elles renvoient.
À l’image des préludes et fugues du Clavier bien tempéré de Johann Sebastian Bach, chaque étude consiste en deux morceaux dont le second est, dans la plupart des cas, une fugue ou, en tout cas, présente un caractère fugué. Les deux morceaux partagent la même tonalité dans 24 de ces études et ont des tonalités homonymes (majeur-mineur) dans les autres. Contrairement à l’ouvrage de Bach, le parcours de tonalités ne semble pas avoir ici de structure particulière.
Le titre de ce recueil a quelque chose de quelque peu mystérieux. Chacune de ces 34 Études est, à première vue, composée d’une étude qui n’est pas fuguée et d’un morceau fugué qui n’est pas une étude. Cependant, dans sa préface, Reicha désigne toutes les pièces de l’œuvre comme étant du genre fugué et ses remarques préliminaires indiquent aussi que les premiers morceaux de chaque paire ont des traits qui, pour lui, s’intègrent à ce concept. Dans ses remarques, Reicha décrit douze des morceaux comme « fugue » et donne des conseils pour composer avec cette forme. Cependant, dans la préface, il emploie systématiquement l’expression « le genre fugué » plutôt que le mot « fugue », bien que ses remarques fassent clairement référence aux fugues. L’un des sous-titres de l’édition originale est « pour l’usage des jeunes compositeurs ». Reicha entendait-il par là que ces fugues ne servaient pas pour apprendre les règles de la forme, mais pour donner à ces « jeunes compositeurs » des idées pour la composition d’une fugue que, pour éviter les reproches éventuels de leurs professeurs, ils appelleraient « pièce dans le genre fugué » plutôt que « fugue » ? Le terme « étude » s’applique en général à un morceau qui démontre un aspect particulier de composition ou de technique. Cependant, en tenant compte des idées que Reicha exprime dans ses divers traités, peut-être ne faut-il pas considérer cette œuvre comme une collection de 34 études individuelles, mais comme une étude générale sur l’écriture dans le genre fugué.
Quelle que soit la raison qui poussa Reicha à donner à son œuvre ce titre un peu trompeur, on est loin ici de l’idée d’une étude comme exercice technique. Ce recueil est plein de surprises, incluant des airs simples, des canons, des variations, des séquences harmoniques qui semblent évoquer un esprit romantique du 20e siècle plutôt que du 19e siècle, même des cloches d’église et, bien sûr, une grande variété de fugues.
Les remarques qui précèdent les études ne semblent pas avoir l’engagement que l’on trouve habituellement dans les écrits de Reicha, tels que les commentaires qui préfacent le recueil de morceaux pour piano intitulé Practische Beispiele. Cette œuvre étant présentée en tant qu’études, Reicha se sentit peut-être obligé de la commenter de façon pédagogique. Bien qu’elles présentent un certain intérêt historique, ces remarques du compositeur ne donnent pas une idée réelle de la fraîcheur et de l’inventivité que l’on trouve dans la musique.
Trois collections de fugues pour piano de Reicha existent : les 36 Fugues de 1803, que Beethoven critiqua sévèrement (« La fugue n’est plus la fugue »), les 6 Fugues de 1810, et celles de ces 34 Études op. 97. Nous ne connaissons qu’une seule fugue pour piano qui aurait été composée par Reicha postérieurement à celles de ce recueil. Elle se trouve dans son Traité de haute composition musicale, publié en 1824. C’est une fugue annotée, ayant comme titre Fugue instrumentale à 3, dans le style moderne. Nous suggérons donc – sans réelle certitude cependant – que le dernier morceau des 34 Études op. 97 est la dernière fugue pour piano qu’écrivit Reicha sans visée pédagogique. Son thème est large et noble et on trouve dans les mesures qui mènent vers la fin tout un échantillon de techniques typiques de la fugue – stretto, augmentation, diminution. Pourtant il n’y a rien de cette complexité à la fin de la fugue, qui se termine de manière très simple avec un accord de septième de dominante résolue à la tonique, comme si, avec cet adieu à la fugue pour piano, Reicha disait « Voilà ! C’est tout ! C’est la musique. »
Dans le Journal des Débats daté du 3 juillet 1836, Hector Berlioz écrivait : "II existe plus de cent œuvres gravées de la composition de Reicha sans compter un grand nombre d’autres, encore manuscrites, et parmi lesquelles plusieurs sont pour l’art de la plus haute importance."
Partition pour piano. Publication en 4 cahiers.
Michael Bulley
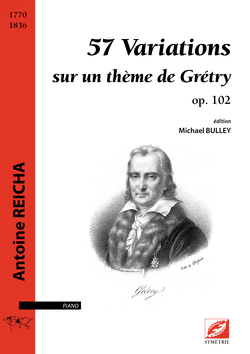 57 Variations sur un thème de Grétry op. 102 d'Antoine Reicha (1770 – 1836)
57 Variations sur un thème de Grétry op. 102 d'Antoine Reicha (1770 – 1836)
Cette édition des 57 Variations sur un thème de Grétry se fonde sur la seule source existante, à savoir l’édition publiée par Zetter à Paris en 1824 sous le titre Étude de Piano ou 57 Variations sur un même thème suivies d’un Rondeau. Le thème concerné est essentiellement le même que celui d’un passage instrumental du deuxième acte de l’opéra d’André-Ernest-Modeste Grétry, Panurge dans l’isle des Lanternes, créé à l’Académie royale de musique à Paris le 25 janvier 1785.
Reicha fait référence à Grétry de manière élogieuse à plusieurs reprises dans ses écrits autobiographiques et dans ses traités. En 1814 déjà, il composait une cantate, Hommage à Grétry, contenant plusieurs thèmes tirés de ses opéras et dans le premier mouvement de laquelle le chœur chante « Las ! Il n’est plus… pleurons le chantre aimé des cieux… pleurons Grétry ! » L’hypothèse, généralement acceptée de nos jours, que Reicha ait emprunté son thème à l’opéra Panurge dans l’isle des Lanternes est la raison pour laquelle son œuvre est souvent intitulée Variations sur un thème de Grétry, pratique suivie pour la présente édition. Néanmoins, le nom de Grétry n’apparaît nulle part dans l’édition de 1824 et bien qu’il soit presque certain que Reicha connaissait Panurge dans l’isle des Lanternes, nous n’avons aucun document confirmant que cette œuvre était bien la source du thème des variations. Il n’est donc pas à exclure que les deux compositeurs ont emprunté une mélodie traditionnelle.
Dix années environ après ses Variations sur un thème de Gluck, Reicha renoue donc avec le genre de la variation pour piano, et ce n’est probablement pas un hasard s’il choisit d’écrire précisément 57 variations, un nombre qui, de manière évidente, fait référence à ses 57 Variations pour le Piano-Forte op. 57, dites L’Art de Varier, de 1804, œuvre monumentale décrite par Rainer Schmusch comme « une sorte de traité composé ». Il semble peu probable que ces diverses utilisations du numéro 57 soient le simple fruit du hasard. Nul doute donc qu’il y ait encore quelque chose à découvrir qui pourrait nous éclairer sur la personnalité de ce compositeur dont on sait qu’il était passionné de mathématiques.
Au thème principal de ces Variations sur un thème de Grétry, Reicha adjoint le titre « Gavotte française ». De même, le compositeur ajoute à plusieurs de ces variations un titre descriptif qui fait clairement référence au genre de la suite de danses baroques, telle que pratiquée notamment par François Couperin. Quelques-unes de ces variations ont en outre un sous-titre indiquant un mode d’articulation, tel que legato ou staccato, qui semble renvoyer au terme « Étude » contenu dans le titre original.
Bien que caractérisée comme une Étude de Piano dans l’édition originale de 1824, ces Cinquante-sept Variations sur un thème de Grétry n’ont pas le caractère pédagogique et didactique qui fait la richesse de L’Art de Varier. Il s’agit ici d’une démonstration plus que d’une leçon. La grande variété de styles et un recours souvent ingénieux à l’écriture en imitation place cette œuvre comme une continuation logique et évidente de l’op. 57 qui reste comme la référence du compositeur pour ce qui est du genre de la variation pour piano.
Partition pur piano. Durée : environ 43 minutes.
Michael Bulley
 Trois Epigrammes d'Henri de Régnier de Guy Sacre (° 1948)
Trois Epigrammes d'Henri de Régnier de Guy Sacre (° 1948)
Que nul, à ce mot d’épigramme, ne se méprenne : il ne désigne pas ici le trait d’esprit vengeur, la flèche décochée avec adresse. Régnier l’emploie dans son sens le plus grec, le plus primitif : une « inscription » ; disons plus simplement un poème, où la brièveté est de règle et dont la chute, à défaut de percer un ennemi, doit « s’inscrire » durablement dans la mémoire. Sur des sujets aussi rebattus que l’amour et la mort, la fuite du temps, la force du souvenir, ces trois-là auraient de quoi tenir ce pari difficile ; mais il y a longtemps qu’on ne lit plus Régnier, coupable d’avoir traîné jusqu’en 1930 un métier appris sous Mac-Mahon. Je ne prétends pas que l’ajout de mes notes puisse lui redonner beaucoup de lustre ; peu importe, d’ailleurs, aux vrais amoureux du vers, comme aux vrais amateurs de ce genre périlleux qu’est la mélodie…
On m’eût dit, dans mes vingt ans, qu’un jour je mettrais Régnier en musique, je me serais récrié. Le poète des Médailles d’argile ou des Jeux rustiques et divins n’entrait pas dans mon vaniteux petit Parnasse portatif, dont les dieux majeurs se nommaient Mallarmé et Valéry. Curieusement, c’est à la musique que je dois de l’avoir ensuite fréquenté davantage : Le Jardin mouillé de Roussel, un des sommets de la mélodie française, m’a révélé du même coup un sommet de notre poésie. Je confesserai encore ceci : en découvrant les Épigrammes, en décidant de m’en servir, j’ai refoulé une ancienne méfiance, la crainte, en musique, de l’alexandrin, ce vers auquel peut souvent s’appliquer, hélas, un de ceux de Racine : « Sa croupe se recourbe en replis tortueux »… Mais non, j’ai trouvé des vers très purs, sans poids ni pose, auxquels j’espère avoir conservé leur souplesse émouvante, leur merveilleuse ductilité.
Partition pour voix moyenne et piano. Durée : environ 5 minutes.
Guy Sacre
 Deux Poèmes français de Rilke de Guy Sacre (° 1948)
Deux Poèmes français de Rilke de Guy Sacre (° 1948)
En hiver, la mort - A la bougie éteinte
On ne sait pas toujours que Rilke, au soir de sa vie, a écrit quelques poèmes en français. Il en donne un motif admirable au milieu même de son recueil Vergers :
Peut-être que si j’ai osé t’écrire,
langue prêtée, c’était pour employer
ce nom rustique dont l’unique empire
me tourmentait depuis toujours : verger.
Qu'un seul mot, et des plus fragiles, puisse entraîner à tout un exercice, voilà qui doit continuer à nous émouvoir. N’est-ce pas aussi, parfois, par la grâce d’un seul poème, mystérieusement élu, qu’un compositeur se mue soudainement en interprète et tâche, à des mots pourtant définitifs, de donner un surcroît de saveur, sinon de sens ? D’autres, pour ce Rilke français, l’ont fait avant moi : Milhaud (les Quatrains valaisans), Durey, Barber, Hindemith. J’ignore à quoi, devant ces pages, ils voulaient répondre, mais je puis dire ce qui m’y a retenu : le tremblement, bien perceptible à qui approche son oreille, d’un langage en effet « prêté », et qui n’échappe pas (qui ne veut peut-être pas échapper) aux plis, aux creux, aux gaucheries étranges de l’étranger, non moins valables, entre les mains d’un tel artiste, que l’exactitude lisse et lustrée de l’indigène, – et souvent chargés, comme la fausse note en musique, d’une inexplicable et violente beauté.
Partition pour voix moyenne et piano. Durée : environ 3 minutes.
Guy Sacre
 Deux Poèmes de Jean Pellerin de Guy Sacre (° 1948)
Deux Poèmes de Jean Pellerin de Guy Sacre (° 1948)
Ce souffle qui chante - Quand mon fil se cassera
Un poète de cette qualité peut-il disparaître corps et biens ? Non pas seul, d’ailleurs : avec Carco, Derème, et quelques autres de cette « école fantaisiste » qui, en marge des bruyantes révolutions de l’art et de la littérature, celles où toujours un clou chasse l’autre, se piquait seulement de savoir faire des vers. Et quels vers ! Virtuosissimes, à la fois délectables et délictueux, plus retors qu’il n’y paraît, ne sacrifiant à la rime, luxueuse, au rythme, acrobatique, à l’enjambement, espiègle et farfelu, que dans la mesure où la pensée s’en trouvait plus acérée encore, entre humour et mal de vivre, entre ironie et désespoir. Leur maître, Paul-Jean Toulet, est encore un peu vivant, grâce à quelques accents (« Prends garde à la douceur des choses ») qui persistent dans toutes les mémoires. C’est à son art de l’esquive, de la pudeur émue, que s’apparentent les deux poèmes de Jean Pellerin que j’ai voulu mettre en musique ; on y parle, une fois de plus, de l’amour et de la mort, ces deux figures obligées de notre théâtre ; et si dans le second la douleur s’exprime sans ambages, c’est qu’à ce masque-là l’acrobatie d’une rime ou d’un rejet n’enlève rien de sa gravité.
Partition pour baryton et piano. Durée : environ 3'15''
Guy Sacre
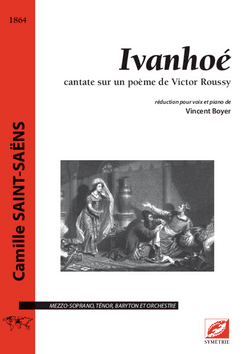 Ivanohé, cantate sur un poème de Victor Roussy de Camille Saint-Saëns (1835 - 1921)
Ivanohé, cantate sur un poème de Victor Roussy de Camille Saint-Saëns (1835 - 1921)
Bien loin de constituer un ouvrage isolé dans l’œuvre de Camille Saint-Saëns, Ivanhoé appartient à un ensemble réalisé dans le contexte particulier du concours pour le prix de Rome. Institué en 1803, supprimé dans la foulée des événements de mai 1968, ce dernier fut pendant longtemps le plus convoité des prix français de composition musicale. Organisé par l’Institut, il garantissait à ses lauréats, à défaut de l’assurance d’une future carrière sans embûches, du moins l’entrée par la grande porte dans le monde artistique et quelques années de pension en Italie, à la villa Médicis. De fait, bien peu résistèrent à l’attrait de cette récompense susceptible de marquer avec éclat l’aboutissement de longues années d’études. Que l’auteur de la Danse macabre s’y soit présenté n’a finalement rien d’étonnant. Mais bien qu’appelé à devenir au tournant du siècle l’un des plus illustres représentants de l’art académique, il n’obtint jamais le fameux premier grand prix. Certes, il serait aisé de mettre son premier échec, en 1852, sur le compte de l’inexpérience, mais son second et dernier, douze ans plus tard, demeure plus surprenant : ayant presque atteint la limite d’âge, le musicien n’est alors plus un novice. Est-ce sa situation d’artiste déjà établi qui lui valut d’être écarté ? Rien ne peut le confirmer, mais il n’en reste pas moins qu’après avoir été placé en tête des six candidats admis à l’épreuve finale en juin 1864, il échoua finalement au profit de Victor Sieg, camarade appelé à un destin autrement plus modeste.
Composé par Victor Roussy, le livret d’Ivanhoé s’inspire d’un épisode du roman éponyme de Walter Scott. Tout en répondant aux obligations d’une cantate de Rome, il exploite différents antagonismes susceptibles de mettre en valeur les candidats les plus talentueux. Sur fond de tensions entre Saxons et Normands dans l’Angleterre de la fin du 12e siècle, il développe l’amour impossible et unilatéral de la juive Rebecca pour le chrétien Ivanhoé, la grandeur d’âme de ce dernier répondant à l’ambiguïté de son ennemi Bois-Gilbert, pris quant à lui par son désir pour la jeune israélite. Entre histoire et religion, c’est un véritable petit opéra qui se développe dans ces cinq courtes scènes.
Bien qu’inégale, la partition de Saint-Saëns est remarquablement variée. Si certains airs purement strophiques peuvent sembler convenus, on ne peut qu’admirer son sens de la mélodie, l’efficacité de ses progressions dramatiques ou certaines fulgurances comme cet étonnant épisode vocal sur une simple note tenue. Œuvre de transition, Ivanhoé n’en contient pas moins certains aspects d’une écriture déjà personnelle, notamment cette volonté d’unification par des motifs conducteurs ou son goût prononcé pour les trames orchestrales denses qu’une instrumentation limpide vient éclaircir. Autant de qualités que le musicien ne tardera guère à mettre en pratique… son chef-d’œuvre lyrique, Samson et Dalila, ne fut-il pas entrepris dès 1867 ?
Partition pour mezzo-soprano, rénor, baryton et orchestre. Réduction pour voix et piano de Vincent Boyer. Durée : environ 30 minutes.
Cyril Bongers
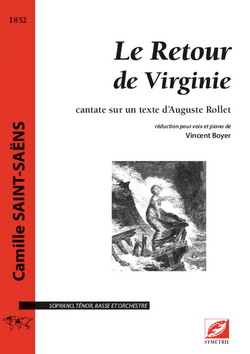 Le retour de Virginie, cantate sur un texte d'Auguste Rollet de Camille Saint-Saëns (1835 – 1921)
Le retour de Virginie, cantate sur un texte d'Auguste Rollet de Camille Saint-Saëns (1835 – 1921)
Bien loin de constituer un ouvrage isolé dans l’œuvre de Saint-Saëns, Le Retour de Virginie appartient à un ensemble réalisé dans le contexte particulier du concours pour le prix de Rome. Saint-Saëns est encore un jeune musicien inexpérimenté lorsqu’il s’inscrit au concours pour la première fois. Élève d’Halévy depuis 1849, il n’a que seize ans lorsqu’il entre en loge en juin 1852 pour la réalisation d’une fugue et d’un très joli Chœur des sylphes. Classé en tête des candidats à l’issue de ces premières épreuves, c’est sans doute avec une certaine confiance qu’il aborda, du 26 juin au 21 juillet suivant, la composition de sa cantate Le Retour de Virginie sur un poème d’Auguste Rollet d’après le roman de Bernardin de Saint-Pierre. Sa déception dut être grande à la proclamation des résultats : préférant couronner le travail de Léonce Cohen, le jury ne lui attribuait finalement aucune récompense. Bien des années plus tard, il reconnaîtra toutefois le bien fondé d’un jugement sans doute destiné à le retenir encore un peu sur les bancs du Conservatoire. C’est que tout en laissant entrevoir les réelles qualités de son auteur, cet ouvrage, il est vrai un peu hétérogène témoigne avant tout d’un musicien encore en devenir, subissant de très fortes influences. Ainsi, entre imitation à peine masquée de Mendelssohn et éléments de bel canto post-rossiniens, à travers l’exotisme de pacotille de la Danse nègre introductive, ou le final rappelant l’apothéose de Marguerite de La Damnation de Faust, il serait vain et illusoire de chercher à apprécier cette cantate à travers l’unique prisme de son auteur, fût-il appelé à un glorieux avenir. Œuvre de concours, œuvre de jeunesse, empreinte de savoirs autant que d’admirations où de naïvetés, c’est avant tout comme le précieux témoignage d’une esthétique à part qu’il convient aujourd’hui de l’aborder si l’on tient à en goûter pleinement les indéniables réussites…
Partition pour soprano, ténor, basse et orchestre. Réduction pour voix et piano de Vincent Boyer. Durée : environ 30 minutes.
Cyril Bongers









