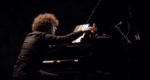Le jeune Walden festival (c’est sa deuxième édition) se positionne dans l’air du temps : un lieu (plusieurs en fait, à quelques minutes de marche l’un de l’autre), original, confortable, auguste ou impressionnant (ici, les quatre), une gestion respectueuse de l’environnement (on mange végan, on trie ses déchets, on ne s’empile pas les uns sur les autres, on prend le temps de flâner), une programmation à la densité raisonnable – les ingrédients sont communs, mais œufs, farine, sucre et beurre ne font un bon quatre-quarts qu’avec la main habile du pâtisser avisé, en l’occurrence le Festival van Vlaanderen Brussel, puisque le Walden se veut le pendant informel du Klarafestival, créé en 2004 et devenu le plus grand rassemblement belge de musique classique (en mars à Bruxelles, Anvers et Bruges).
Le contenant, mais aussi le contenu
Un lieu, donc : le parc Léopold, écrin de nature au centre du quartier européen à Bruxelles (à portée d’archet du Juste Lipse et du Berlaymont), oublié à l’heure de pointe entre la rue Belliard, les frites de chez Antoine à la place Jourdan et la Maison de l'histoire européenne ; le parc et ses trésors, la Bibliothèque Solvay, le Lycée Emile Jacqmain, le Musée Wiertz ou le Muséum des sciences naturelles (rebaptisé « dino » pour l’occasion… et son contenu) – sans compter la Chapelle pour l’Europe ou l’Espace Senghor. Et bien sûr, le jardin du Muséum, point de rassemblement, avec chapiteau, stand chapeau de paille et tote bags, bar et motos food trucks aux devantures carrelées de blanc tels les murs du métro parisien.
Le programme (qu’il ne s’agit pas d’oublier au bénéfice du décor), se love dans les traces de Walden, l’émission de slow radio éponyme de Klara (VRT) – slow, cette façon d’agir et d’être, lente, en opposition à la frénésie d’une société de consommation que plus grand-chose ne freine : « une oasis de calme en paroles et en musique, du Moyen Âge à nos jours ». Vague, large, imprécis : alors je sélectionne, une orientation jazz le samedi, contemporain le dimanche.
Samedi soir, jazz d’aujourd’hui en mer intérieure
J’affectionne le oud, ce luth à manche court, entendu chez Dhafer Youssef ou Anouar Brahem et suis curieux de découvrir le Rabih Abou-Khalil Trio, qui compte sur le violon de Mateusz Smoczynski et les percussions (batterie et tambour sur cadre) de Jarrod Cagwin – une configuration un peu particulière. Abou-Khalil, libanais et pétri d’autodérision (« Il ne faut jamais acheter quelque chose chez les arabes. Dès que je l’ai payé, mon oud s’est désaccordé. »), se met, bonhomme, le public dans la poche, dès l’entame d’une série de morceaux, souvent percussifs, parfois nostalgiques (« si tu me quittes, il faut que j’en trouve une autre, et c’est beaucoup de travail ») : sympathique, mais avec moins de profondeur que Brahem et sans la voix démentielle de Youssef.
Le projet, à l’évidence, attire la bienveillance : l'Orchestre des Jeunes de la Méditerranée, conduit depuis 2015 par Fabrizio Cassol (le saxophoniste d’Aka Moon), s’inspire des musiques de la méditerranée (folklore, jazz…), improvise, joue de tête, les musiciens partagent joyeusement la scène, mélangent timbres et couleurs (malgré les cris des perruches qui volent d’un arbre à l’autre)… mais ne me convainquent pas – je rentre plus tôt que prévu au centre Adeps où j’ai loué une chambre (original, tiens) et en profite pour terminer le roman de David Joy, indien de Caroline du Nord, à l’âme noire et malgré tout porteur d’espoir.