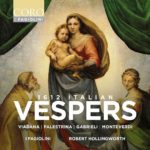Interviews
L’excellent chef d’orchestre espagnol Roberto Forés Veses, bien connu du public français, vient de prendre ses fonctions de directeur artistique de l’Orquesta de Extremadura en Espagne. Il est, par ailleurs, Principal chef invité de l’English Chamber Orchestra basé à Londres tout en menant une carrière international de haut vol. En prélude à un concert avec l’Orchestre national du Capitole de Toulouse, Roberto Forés Veses répond aux questions de Crescendo-Magazine.
Cette saison vous prenez vos fonctions comme Directeur artistique de l'Orquesta de Extremadura en Espagne (OEX). Comment avez-vous rencontré cet orchestre ?
J'ai rencontré cet orchestre en 2014. C'était la première fois que j'étais invité à leur pupitre et ensuite il y a eu 3 autres invitations et tous les concerts se sont toujours très bien passés. Nous avons exploré des œuvres d’un répertoire assez large : Symphonie n°104 de Haydn, Symphonie n°2 de Nielsen, Symphonie n°5 de Sibelius et Concerto pour orchestre de Bartók. Mon parcours m’a conduit à diriger des orchestres de chambre où la notion de famille est importante dans l’approche commune de la musique. J’ai tout de suite ressenti ce sentiment avec les musiciens de l’OEX. Au fil de ces 4 invitations, nous sommes devenus de plus en plus proches et il y a un an, alors qu”ils cherchaient un directeur musical, ils m’ont contacté pour me proposer de devenir leur Directeur artistique.
Quelle est votre ambition et quels sont vos projets pour cet orchestre ?
La première étape est de placer l’OEX dans le panorama des orchestres espagnols. L’orchestre est basé à Badajoz dans la province d'Estrémadure, dans le sud-ouest de l’Espagne. Nous envisageons des concerts dans de grandes villes. Nous allons jouer à Madrid, ce qui est très important pour nous, mais aussi à Séville, qui est une autre grande ville pas si éloignée de Badajoz. Enfin, nous avons dans les plans de nous rendre au Portugal, à Lisbonne, car nous ne sommes qu'à deux heures de la frontière. Mon ambition est de donner une identité à cet orchestre qui est très jeune car il a été fondé en l’an 2000. L’OEX est un groupe de musiciens qui joue déjà très bien et naturellement, une seconde étape sera le développement à l’international.
Quels sont les répertoires que vous allez développer ? Est-ce que vous allez programmer de la musique espagnole et je pense en particulier à Manuel de Falla, dont on célébrera l'anniversaire des 150 ans de la naissance en 2026 ?
Nous allons être très attentifs à la musique espagnole et spécialement pour la saison prochaine. Je veillerai à programmer de la musique contemporaine car nous avons des compositeurs émergents de très grands talents ! Par ailleurs, c'est mon premier poste musical dans mon pays et je souhaite également programmer des œuvres qui m’accompagnent dans mon parcours de chef d’orchestre. J'envisage le développement du répertoire sur plusieurs saisons, il y a tant de choses à faire !
La mezzo-soprano Coline Dutilleul fait paraître, chez Ramée, un album qui nous plonge dans les musiques des Salons du Premier Empire avec la découverte de très belles partitions, bien trop méconnues. La tournaisienne prend également par un album Musique en Wallonie qui nous fait découvrir les œuvres de la compositrice belge Lucie Vellère. Coline Dutilleul nous parle de ces deux parutions.
Votre album porte le titre Au salon de Joséphine et il propose des romances et des airs d’opéra de l’époque du Premier Empire. Ce n'est pas un choix commun. Qu’est-ce qui vous a motivée à vous lancer dans ce concept éditorial ?
Le format intimiste de la musique de salon m’a toujours fascinée. J’aime raconter des histoires, vivre la musique à travers les mots et trouver ainsi une proximité avec l’auditeur que l’on peut rencontrer dans cette forme de concert plus intimiste.
Je me suis donc penchée sur cette époque avec Aline Zylberajch qui avait déjà une grande connaissance du répertoire en tant que pianofortiste, d’abord dans un projet sur les salons strasbourgeois du maire Dietrich à l’époque de la Révolution, avec une grande part de recherches à la bibliothèque de Strasbourg où nous avons découvert des partitions complètement inédites mais aussi des réductions d’orchestre, usage musical qui se développe beaucoup à l’époque dans le cadre du concert au salon. On entendait un opéra ou d’autres pièces de grande envergure avec orchestre et on s’attelait à les transcrire pour les jouer sur les instruments que l’on pouvait posséder à la maison : la harpe, le pianoforte, la guitare, parfois aussi des dessus comme la flûte ou le violon.
A l’époque, nous venions de rentrer dans les années Covid, il était donc aussi important de penser à de petites formes en musique de chambre. J’ai rencontré la directrice du château de Malmaison (Elisabeth Caude) qui m’a mise en contact avec des musicologues de la fondation Napoléon et ceux du château, et nous avons élaboré un axe de recherches pour essayer d’imaginer un programme qui aurait pu être joué dans le salon de la Malmaison en mettant l’accent sur les romances (les mélodies de l’époque), les airs d’opéra sérieux et bouffe en français et en italien, très présents dans cette « mode » des opéras au salon née à Paris sous la Régence, ainsi que des pièces instrumentales pour les instruments favoris de l’époque : la harpe et le pianoforte.
J’ai aussi personnellement décidé d’axer le choix des textes sur des thématiques dans lesquelles j’avais envie de m’exprimer, laissant de côté les airs patriotiques ou coloniaux, par exemple, n’ayant pas envie d’entrer dans des sujets politiques.
Après plusieurs concerts en trio, invitées notamment par La Nouvelle Athènes (centre des pianos romantiques de Paris) qui nous a programmées dans le cadre du festival de Pentecôte au Château de Malmaison, nous avons décidé de proposer ce programme au disque, gardant cette idée d’un voyage musical dans une époque qui s’écouterait comme un concert au salon.
Comment avez-vous sélectionné les compositeurs et les œuvres présentés sur cet album ?
Comme expliqué plus haut, l’impératrice Joséphine, mais aussi Napoléon avaient des goûts musicaux dont ils ne se cachaient pas.
J’ai trouvé dans des ouvrages musicologiques sur le Premier Empire, des compositeurs qui gravitaient autour de Malmaison, ainsi que des chanteurs adorés par Joséphine, comme le célèbre Garat.
Il existe aussi des périodiques musicaux de l’époque (Le Journal d’Euterpe) dans lesquels on peut retrouver des arrangements et des pièces inédites.
Évidemment, nous voulions aussi mettre à l’honneur Hortense de Beauharnais, la fille du premier mariage de Joséphine, qui avait de nombreux talents musicaux.