A Genève, une saisissante Lady Macbeth de Mtsensk
En 2014, alors qu’Aviel Cahn était directeur de l’Opéra des Flandres, Calixto Bieito collaborait avec le chef d’orchestre Dimitri Jurowski pour présenter Lady Macbeth de Mtsensk de Chostakovitch avec Aušrine Stundyte dans le rôle de Katerina Ismailova et Ladislav Elgr dans celui son amant, Sergueï. Neuf ans plus tard, le metteur en scène et les deux chanteurs se retrouvent au Grand-Théâtre de Genève pour reprendre cette production, tandis que, dans la fosse d’orchestre, figure le chef argentin Alejo Pérez qui oeuvra ici avec le régisseur pour Guerre et Paix en septembre 2021. Et la réussite de cette seconde entreprise longuement mûrie dépasse toutes les espérances par son indéniable achèvement.
Créée au Théâtre Maly de Leningrad le 22 janvier 1934 sous la direction de Samuel Samossoud, l’œuvre est représentée quatre-vingts fois à Leningrad, près de cent fois à Moscou, avant que ne soit publié Tohu-bohu à la place de la musique, article incendiaire de la Pravda qui marque son interdiction voulue par Staline. Préalablement pour une présentation, le compositeur écrivait : « Même si Katerina Lvovna est une meurtrière, elle n’est pas une ordure… Sa vie est morne et inintéressante. Alors entre dans sa vie comme un amour. Et cet amour vaut un crime pour elle… Au nom de l’amour, elle est capable de tout, même du meurtre ».















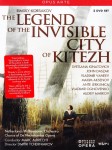
 Nicolai RIMSKY-KORSAKOV
Nicolai RIMSKY-KORSAKOV