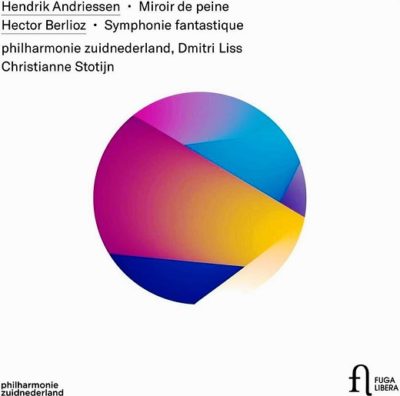Une Fantastique inégale, plus appliquée qu’impliquée
Hector Berlioz (1803-1869) : Symphonie fantastique, opus 14. Hendrik Andriessen (1892-1981) : Miroir de peine. Dmitri Liss, Philharmonie Zuidnederland. Christianne Stotijn, mezzo-soprano. Enregistrements publics à Eindhoven et Maastricht, octobre 2017 & avril 2019. Livret en anglais, français, néerlandais. TT 68’20 Fuga Libera FUG 764
Désolé pour l’évaluation du livret, mais malgré son angle intéressant (la dynastie des Andriessen, la biographie de Berlioz en lien avec son Épisode de la vie d’un artiste), il renseigne bien pauvrement sur les deux œuvres, et ne fournit pas les paroles (en français) de la rare cantate Miroir de peine pour voix soliste. À l’origine (1923) conçue avec accompagnement d’orgue, puis instrumentée telle que nous l’entendons ici. Le titre des cinq séquences (Agonie au jardin, Flagellation, Couronnement d’épines, Portement de croix, Crucifixion) laisse deviner la thématique de la Passion du Christ, qui s’accommoderait d’une sobre prestation vocale (moins voluptueuse et vibrée) et de tempi moins hâtifs.
La Fantastique constitue la pièce principale du CD. L’approche du premier mouvement synthétise les qualités et limites de l’interprétation de toute la symphonie. Les Rêveries s’étirent avec suavité (cordes chaleureuses, bois bien intégrés), au gré d’un prologue tout en douceur. Le senza rallentando (4’14) s’extrait mollement de la torpeur, vers un allegro agitato (5’17) tempéré, et dont la reprise est pratiquée (7’03). On regrette toutefois que les Passions restent inoffensives. Clarté, lisibilité, oui. Mais sans la transe : escalade vers la Grande Pause (9’34) guère exaltant. L’élégance modère les moments d’excitation, comme au chiffre 13 (10’43) dont on admire certes l’élasticité. Les présages du chiffre 16 (12’10), instillées par le hautbois, n’instaurent pas le laboratoire de machinations qu’on attendrait. La mise en tension (jusque l’impact à 14’04) n’est pas branchée sur les voltages auxquels nous ont habitués les baguettes audacieuses. Globalement, le dramatisme du tableau se trouve romancé plutôt que véritablement polarisé ; les accès de fureur et de jalousie se trouvent édulcorés. Le relief de la prise de son ne pallie pas les carences de suggestivité, ne supplée pas le lissage de l’émotivité. Les turbulences en ressortent civilisées, l’inspiration en ressort classicisée. Pour situer ce témoignage face à des antécédents notoires, on pense à André Cluytens avec le Philharmonia (Columbia, novembre 1958) pour l’euphémisation, ainsi qu’à Herbert von Karajan à Berlin (DG, préférer celle de 1964 à l’artefact de 1974) pour le matériau cossu et les langueurs subsumées par l’onirisme.
Un Bal dévide sa célèbre mélodie (0’42-1’15) sur un ton nostalgique, platement cérémonieux, où les violonistes ne cherchent ni le luxe mondain ni l’émoustillement des couples enlacés. Phrasé peu imaginatif (alors que la partition précise des portamentos d’archet peu exploités par le chef). Notons que le cornet à pistons (facultatif, et déconseillé par l’éditeur Breitkopf) est employé, il surnage particulièrement à 2’02. L’apparition de l’idée fixe (2’16) nous plonge dans quelque bluette tchaïkovskienne et ne semble pas bouleverser le héros, auquel le retour de la danse est censé faire obstacle (3’21). En tout cas, la polyphonie est finement rendue, ainsi au chiffre 31 (4’26) contrepointé par le cornetto. Le poco ritenuto (5’36) distille une tendre clarinette qui s’illusionne de l’idylle, mais avant lui l’animato (4’56) et surtout le con fuoco (6’08) sont loin des fièvres et des tourbillons qui devraient engendrer les déceptions et le dérèglement des sens. Plutôt que s’exposer au trouble violent, l’expression s’abrite dans un bovarysme trahissant le contexte et le langage de cette partie qui n’a pourtant rien d’un tiède intermède de ballet.
L’angélisme qui jusque-là affadit cette lecture correspond maintenant aux besoins de quiétude de la Scène aux champs, dont la spatialisation initiale est bien restituée dans l’acoustique, offrant un havre d’oubli au héros réfugié dans les vertes montagnes. L’éclaircissement progressif de ses états d’âme, ses emports de joie (4’24), son abandon aux charmes rustiques (cordes graves et basson) de l’accueillant paysage (5’54), ses craintes (7’19) narguées par la bien-aimée (7’30) : là encore, l’orchestre néerlandais se montre habile traducteur de ces ambiances larvées. En revanche, le paroxysme martelé par les baguettes de bois (8’36), on l’aurait voulu plus terrifiant. Avait-on décidé de ne pas choquer l’auditeur ?! Le rassérènement (8’56) amène l’engrenage qui se froisse timidement en triple-croches (10’36), sans qu’on se sente transporté par ce tempo léthargique. Nous peint-on le héros trottant anonchali à dos d’âne ?, alors que la jalousie s’empare de lui dans ce térébrant crescendo! On dirait que le chef tient avant tout à rassurer, comme l’atteste la vision consolatrice de la bien-aimée (12’30). Les angoisses s’éteignent dans l’écho des cimes, le retour du ranz-des-vaches (14’33), joué de façon peu expressive, malgré le roulis des timbales, évoque une sorte d’ataraxie.
La Marche au Supplice est réussie : les coups étouffés aux timbales (le cahot de la voiture qui convoie le condamné) sculptent la texture, les cornistes moirent certaines notes, assujettis à un protocole adéquatement inquiétant. Le tempo est retenu mais dynamique. On apprécie la gouaille du bassoniste. La foule en liesse, qui se réjouit de l’exécution, laisse éclater sa clameur (1’43) que la fanfare (on perçoit bien les strates cuivres/bois) sert avec un zèle méthodique plutôt que fanatique. L’orchestre néerlandais se distingue par sa discipline, sans s’acharner. Trombones et tuba (mesure 123, 3’04) n’outrent pas la vindicte sanguinaire. L’hymne sacrificielle (3’17) est ponctuée par une grosse caisse très percutante. Dommage que les pizzicati (4’26) soient amenuisés car ils endossent une signification cruciale, celle de la tête tranchée qui roule dans le panier ! Sans se presser, Dimitri Liss a accompli le rituel des « hautes œuvres » avec un indéniable panache ; la main du bourreau n’a point tremblé.
Bourrasques en sextolets, acidité des feux follets, ricanements des spectres, incantations maléfiques : le maestro se montre attentif aux effets de timbres qui intriguent le début du Songe d’une nuit du sabbat. La narquoise clarinette qui lance l’allegro (1’25) débouche sur un tutti un peu compact mais dans l’ensemble le persiflage convainc, et entraine une ronde tout aussi sardonique (traversée de quelques foucades auxquelles le chef ne nous a pas habitués jusqu’ici !), interrompue par l’échouage des cordes graves (2’40). Parmi la panoplie pittoresque requise par l’œuvre, on se demande toujours à quoi vont ressembler les cloches. Celles que nous découvrons ici, frêles comme un métal fêlé, ne sont pas celles du Kremlin… Le cortège funèbre du Dies Irae (3’22) ne déçoit pas : sombre, menaçant… La Ronde sabbatique (5’10) s’enchaine sans faiblir, et les pupitres néerlandais, sans se forcer, signent leur réelle adresse, d’autant remarquable pour un live. Le crescendo (7’09) nous invite à une orgie bien gérée, même si le thème du Dies Irae s’impose trop lourdement sur celui du Sabbat (7’57) alors que ce passage tire son ivresse de la superposition. Le crépitement du col legno (8’27) manque aussi de volume. La péremptoire conclusion s’active avec puissance (9’05), on sent qu’elle n’entend pas lésiner sur le bouquet final. Ce Sabbat n’est pas le comble du stupre et des horreurs sataniques, ces sorcières n’ont pas complètement vendu leur âme au diable, toutefois ce dernier volet s’avère nettement plus efficace que les trois premiers.
En résumé : on n’osera pas douter que le maestro russe connaisse le contenu programmatique, et l’on regrette donc que ses prudences en escamotent certains tourments, crises, et délires. Même si l’on accrédite les propos hasardeux qui concluent le livret en se demandant si la symphonie est autobiographique, Berlioz y a en tout cas mis beaucoup de lui-même : ses ardeurs, sa mauvaise foi, ses outrages, -un lexique de l’excès dont cet enregistrement ne présente qu’un visage incomplet. Quant à la lettre, à la rigueur d’exécution, voici un très bon concert, avéré par des applaudissements dont l’orchestre peut s’enorgueillir. Même en conditions studio, certaines versions d’antan ne rivalisent pas avec cette cohésion voire cette virtuosité. Et pourtant, la discographie regorge de témoignages plus constamment fidèles à l’imagerie de cette Fantastique. Pour ne pas conclure notre article par un inventaire de références, piochons-en une par une phalange néerlandaise : la Philharmonie de La Haye sous la conduite de Willem van Otterloo (Philips, juillet 1959), pour chacun des cinq volets, une des plus spectaculaires, fantasmatiques et affolantes jamais gravée !
Son : 10 – Livret : 4 – Répertoire : 10 (Berlioz) 7 (Andriessen) – Interprétation : 7
Christophe Steyne