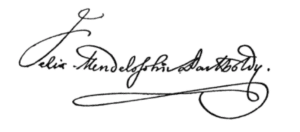Dossier Faust (III) : Faust par Hector Berlioz ou le mépris cinglant des conventions
Chef-d’oeuvre absolu et emblématique du romantisme allemand, la légende de Faust vue par Goethe ne pouvait qu’enflammer l’esprit exalté du plus romantique des compositeurs français. Le drame le plus célèbre de la littérature allemande est pour Berlioz l’histoire de toute une vie et le théâtre de bien des expériences... Dès ses premières années de composition, en 1828 très exactement, Goethe est au centre de ses préoccupations : il compose Huit scènes de Faust qu’il s’empresse d’estampiller fièrement “Opus 1”... et qui serviront de base de départ pour sa future Damnation ! Bien des années plus tard en effet, au cours d’un voyage en Europe Centrale en 1845, il entreprend une composition de bien plus grande envergure. L’inspiration lui vient sans difficulté, les vers comme la musique semblant naître spontanément. Il réécrit le texte, le simplifie, le rend plus direct, moins fouillé : “une fois lancé, je fis les vers au fur et à mesure que me venaient les idées musicales, et je composais ma partition avec une facilité que j’ai bien rarement éprouvée pour mes autres ouvrages”. Rien ne l’arrête dans sa force créatrice et tout son voyage semble ponctué par la mise au point des airs les plus sublimes de la partition. “Je regarde cet ouvrage comme l’un des meilleurs que j’aie produits”, écrit-il encore dans ses Mémoires. L’oeuvre tombera pourtant à sa deuxième représentation devant une salle à moitié vide et entraînera l’infortuné compositeur dans un désastre financier dont il ne sortira qu’à grand-peine.