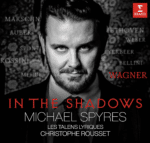« Comment arrivera-t-on à diriger cela ? En avez-vous la moindre idée ? Moi pas ! »
François-Xavier Roth est parvenu, sans nul doute, à diriger l’œuvre « Le Chant de la Terre » de Gustav Mahler. Ce dernier, pourtant chef d’orchestre, prétendait qu’il ne saurait comment faire. La connivence entre l’orchestre Les Siècles, leur chef ainsi que des deux artistes lyriques, a permis au public présent au théâtre Raymond Devos de Tourcoing d’embrasser cette œuvre inouïe.
« Le Chant de la Terre », n’est ni tout à fait une symphonie, ni tout à fait un cycle de lieder. Cette composition n’est pas non plus tout à fait romantique, ni tout à fait moderne. Elle semble atemporelle et inclassable. Les repères complètement évanouis nous amènent à entendre la musique pour elle-même. Ainsi, les timbres, les mélodies de timbres invitent à une sensorialité intense. La pensée et l’analyse nous quittent. Ce voyage auditif parmi les couleurs orchestrales nous emmène dans une quasi-méditation et, quelquefois, dans une totale ivresse auditive. A peine avons-nous apprivoisé un moment, un timbre, une impression, que l’on est emmené ailleurs. Le caractère éphémère et fugace de la musique est comme décuplé. Pour ne rien laisser s’échapper de ces moments fugitifs, l’auditeur se doit d’être pleinement présent. Cependant, ce flux met quelquefois hors de soi dans une sorte d’hypnose ou d’enchantement. Le contraste avec la première partie du concert, « Les Indes Galantes » est saisissant. Rameau, lui, nous laisse le temps d’entendre et de comprendre avec des répétitions de motifs, des formes et structures claires, des rythmes de danse sécurisants.